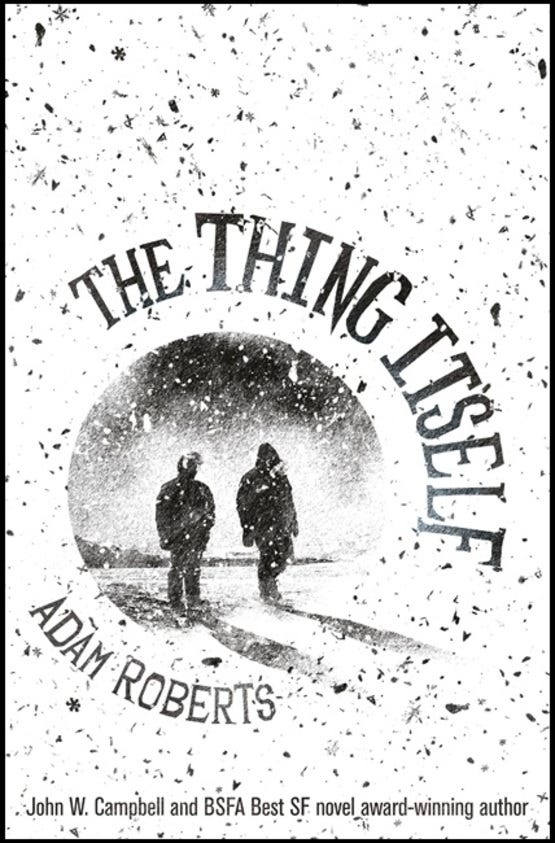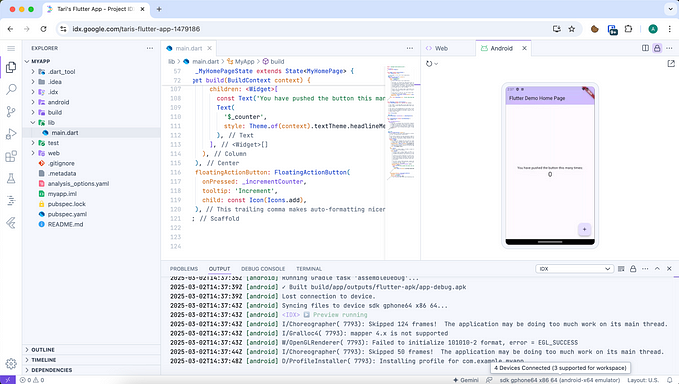La Chose en soi
SF Kantienne
Éditions Denoël, Collection Lunes D’encre, 416 pages
Traduit par Sébastien Guillot
Critique basée sur l’édition VO

Adam Roberts est un auteur de science-fiction et fantasy britannique qui n’a, malheureusement, pas été beaucoup traduit chez nous. C’est Bragelonne qui le publie dans l’Hexagone pour la première fois avec sa nouvelle Swiftly dans son anthologie Fantasy de 2005. Il faut attendre trois ans plus tard pour voir son roman Gradisil sur les étalages des librairies françaises, puis 2014 pour la traduction de son Jack Glass par la défunte collection Eclipse. Écrivain multi-récompensé, Adam Roberts fait en ce moment même parler de lui dans la presse anglophone pour son dernier roman en date : La Chose en Soi / The Thing Itself. Le Times, le Guardian ou encore Locus acclame la dernière œuvre d’Adam Roberts, enchaînant les comparaisons élogieuses. Il n’en fallait pas plus pour se pencher sur cet ouvrage de 357 pages dont le titre — et la couverture ! — ne sont pas sans rappeler le fameux The Thing de John Carpenter.
Tout commence dans le froid…
C’est d’ailleurs en jouant volontairement sur cette comparaison qu’Adam Roberts entame son roman. Sauf que, le lecteur le découvre très rapidement, le récit de La Chose en soi a bien davantage d’ambition. Pour expliquer les nombreuses qualités de l’ouvrage, attelons-nous d’abord à en expliquer le postulat de départ.
Antarctique, 1986.
Charles Gardner et Roy Curtius sont deux scientifiques chargés de récolter et d’analyser des données sur d’hypothétiques signaux extra-terrestres dans le cadre du programme SETI. Comme on peut l’imaginer dans cet environnement hostile pour l’homme, la cohabitation entre les deux n’est pas des plus aisée. Surtout que nos deux scientifiques ne se ressemblent guère. Charles Gardner est un homme assez ordinaire, ouvert, cultivé, parfois drôle quand Roy Curtius est un petit génie froid, renfermé, hautain et calculateur. Ce dernier prétend d’ailleurs avoir accompli un sacré exploit : il aurait résolu le fameux Paradoxe de Fermi (En substance, pour ceux qui ne connaissent pas, Pourquoi n’avons-nous encore rencontré aucune vie extra-terrestre dans un univers aussi vaste que le notre ?).
Comment a-t-il réussi ce tour de force ? C’est simple, avec le livre d’un célèbre philosophe : La Raison Pure d’Emmanuel Kant. Bientôt, Charles s’aperçoit que son collègue sombre dans la folie et celui-ci finit même par tenter de le tuer. Alors qu’il est à l’article de la mort, dans le froid le plus absolu, Charles connaît une expérience atroce : il voit une chose terrifiante l’espace de quelques secondes.
Bien des années plus tard, détruit par ce traumatisme tant physique que psychique, Charles est contacté par une mystérieuse organisation qui se fait appeler l’Institut. Celui-ci lui demande une chose inconcevable : reprendre contact avec Roy Curtius enfermé depuis vingt ans dans un hôpital psychiatrique. Il serait en effet la clé d’une révolution totale pour notre monde moderne.
Voici à peu près le véritable départ de La Chose en soi — bien qu’il soit très difficile de résumer l’intrigue d’un tel roman. Adam Roberts commence donc par une histoire qui rappelle, volontairement, le paranoïaque The Thing pour en réalité partir sur une tout autre voie. Son récit, complexe et brillant, croise deux notions : l’une science-fictive avec un travail autour du Paradoxe de Fermi, l’autre philosophique en s’intéressant à vulgariser la Raison Pure de Kant. De prime abord, les deux n’ont pas grand chose à voir. À ceci près qu’Adam Roberts a une idée de base géniale qui est la suivante :
Selon Emmanuel Kant, nous sommes incapables de percevoir la réalité.
En effet, celle-ci n’est que le résultat de ce que nous transmettent nos sens. Ce que nous voyons, sentons, entendons est tributaire de notre conscience, ce qui signifie que la réalité que nous observons est une conception de notre cerveau mais n’est pas la “vraie réalité”. Celle-ci, qu’il appelle The Thing Itself (La chose en soi), nous est inaccessible par la nature même de nos interactions sensorielles avec le réel.
En suivant ce raisonnement, on résout de facto le fameux Paradoxe de Fermi : si nous n’avons jamais rencontré d’alien, c’est parce que nous sommes incapables de les voir. Adam Roberts tire alors le fil de cette idée pour tisser une œuvre ébouriffante. En effet, si la conscience humaine est la limite qui nous empêche d’approcher la véritable réalité, l’apparition d’Intelligences Artificielles (IA) libère de ce carcan, permettant de vérifier un certain nombre d’interrogations millénaires.
Sommes-nous seuls dans l’univers ?
Dieu existe-t-il ?
Pouvons-nous jouer avec les caractéristiques de notre propre réalité ?
En disciple de Philip K. Dick, Adam Roberts ne fait pas que s’interroger sur le sens du réel mais questionne également les répercussions d’une remise en cause de celui-ci. Dans La Chose en soi, le britannique s’appuie sur le travail de Kant pour emmener son lecteur dans une foultitude d’interrogations toutes plus géniales les unes que les autres. De façon tout à fait remarquable, il vulgarise à tour de bras la pensée Kantienne en employant toutes les analogies possibles et imaginables. Au cours de discussions-fleuves entre ses personnages, il démonte la réalité et offre une perspective géniale au lecteur : si l’on connaît réellement les caractéristiques de la chose en soi, il est possible de modifier à volonté les paramètres du réel. Ainsi, dans la catégorie quantité de Kant, on peut modifier l’espace et ouvrir la voie au voyage sub-luminique. On peut tout aussi bien tordre le paramètre temps et plonger dans le passé. Mieux (mais plus délicat à comprendre), on peut inverser les relations cause-effet. Toutes ces choses qui paraissent bien abstraites dites ainsi sont pourtant parfaitement expliquées et mises en scène par Roberts.
Entrelacement narratif
Au moyen du parcours de Charles Gardner tout d’abord. Ce scientifique loser (et médiocre sur le plan relationnel), est le point d’attache du lecteur dans le fil principal de l’intrigue où Roberts s’amuse à mélanger métaphysique, thriller, complot à la X-Files et Intelligence Artificielle. Le revers de la médaille de la densité des idées abordées, c’est évidemment une certaine aridité du texte. Si Charles fait un temps office de seule balise d’empathie dans cette mer de considérations philosophiques, Roberts prend le risque de perdre son lecteur en route. Sauf qu’il a plus d’un tour dans son sac. Le premier, évident, est que le propos sous-jacent sur la nature de la réalité ainsi que ses multiples développements(L’existence de Dieu notamment…ou même d’autres catégories définissant la réalité et non découvertes par Kant)s’avèrent tellement passionnants que l’on ne décroche pas. Mais surtout, et c’est le second point, Roberts intercale entre les chapitres de son récit principal sur Charles et l’Institut…des chapitres à travers le temps. À la façon d’un David Mitchell, l’écrivain déroule l’écheveau temporel pour pourvoir y distiller davantage d’humanité mais aussi, et c’est là que la chose devient extraordinaire, pour faire correspondre fond et forme.
Exercices Kantiens
Le philosophe Kant avait établi douze catégories au total pour définir la chose en soi. La Chose en soi est découpé en douze chapitres avec, chacun, un sous-titre entre crochets qui se rattache à l’une de ces catégories. Avec un style sans cesse inventif, Roberts retranscrit dans la forme ce que veulent dire les catégories de Kant. L’exemple le plus brillant est bien évidemment le chapitre huit “The Fansoc for Catching Oldfashioned Diseases” où non seulement le britannique imagine une société futuriste transcendée par l’application des théories Kantiennes mais qui, en prime, ne s’exprime plus de la même façon à l’écrit. Tout est causes et conséquences, avec + et — ou =. Même lorsque tout s’embrouille. Rien que ce chapitre spécifique contient plus d’idées que bien des romans science-fictifs. À côté, on suit les histoires de personnages hautement touchants à travers les siècles. Thomas, le serviteur violé et molesté par son maître, la grossesse de Pénélope et son rapport intime à Gibraltar, l’histoire d’amour entre Adonais et un fantôme du voyage dans le temps…Et bien d’autres choses. Ces récits, loin d’être anecdotiques, renforcent la structure de l’intrigue principale, l’approfondissent et vulgarisent encore davantage les choses. Si vous avez du mal avec le concept de “vraie réalité”, peut-être comprendrez vous mieux en vous imaginant dans la peau de deux touristes explorant Francfort à l’aide d’un guide touristique. Comment ? Croyez-vous réellement visiter Francfort ou explorez-vous la ville à travers le prisme du guide ? Ces comparaisons simples mais ultra-efficaces jalonnent le récit de bout en bout donnant une richesse incroyable au texte d’Adam Roberts.

On pourrait encore écrire des pages et des pages sur La Chose en soi mais c’est en définitif assez inutile.
D’une densité incroyable, le récit d’Adam Roberts laisse pantois par son habilité à changer de forme et à jongler avec les thématiques. À la fois drôle, effrayant, vertigineux et remarquablement ingénieux, ce roman-caméléon fascine de la première à la dernière page.
La Chose en soi est un chef d’œuvre, un vrai, tout simplement.
Note : 10/10
N.B : Puisque c’est un paramètre essentiel de la lecture en VO, et avant que la question ne soit posée, il faut un très bon niveau d’anglais pour lire The Thing Itself, non seulement parce qu’il aborde des choses complexes mais aussi parce qu’il y a un vrai travail sur le style qui pourra perturber les moins habitués de la VO.